| H |
| |
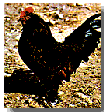 |
 |
|
| >>>Accueil>>Culture et Traditions>Combats de Coqs |
| |
| Origine des combats de coqs : |
| |
| |
L'origine se perd dans la nuit des temps. Les Égyptiens, les
Perses,
les Grecs, les Romains se passionnaient déjà pour
cette coutume. On trouve des représentations de ces luttes d'oiseaux sur une mosaïque de Pompéi, sur des vases du musée de Rome. De nos jours, ils se pratiquent encore aux quatre coins de la planète : en Amérique latine, aux Antilles, en Indonésie, en Thaïlande,... En France, ce sont les Romains qui les ont introduits pour attiser l'ardeur belliqueuse et la bravoure des légionnaires. Abandonnés pendant plusieurs siècles, ils réapparurent au Moyen Age et furent encouragés par les Espagnols lors de leur occupation . Au siècle dernier, il y en avait à Paris, au bois de Boulogne, dans la Somme à Amiens et à Poix, puis ils se localisèrent dans le Nord de la France : dans les Flandres, dans le bassin houiller, à la frontière belge où, contrairement à ce que l'on croit, ils existent toujours (Saint Amand, Vieux-Condé). Au début du siècle, il y avait dans chaque village de la région un gallodrome (parc de combat) et Haspres était connue pour la ferveur de ses coqueleux. |
| |
| Origine du coq batailleur : |
| |
|
Le coq batailleur n'est pas un coq domestique dont on aurait
cultivé et
transmis par hérédité le
caractère agressif. Son ancêtre est le BANKIVA qui
peuple les forêts du nord de l'Inde. Il a son
territoire
délimité et l'intrus est chassé
violemment, parfois même tué. Découvert voici plusieurs millénaires, il fut capturé, élevé, et de cet élevage naquirent plusieurs races de coqs combattants dont on a pu voir cette année de merveilleux spécimens au salon de l'Agriculture : le japonais Shano, le Game cock anglais, l'Américain dit "briseur d'os",... En France, le représentant est le Grand Combattant des Flandres. C'est un oiseau guerrier, bien planté sur de puissantes pattes, une bête "de sang" qui, comme le taureau des corridas, lutte à mort jusqu'à son dernier souffle. Le comparer à un coq de basse-cour serait comparer un loup à un chien... et la race dégénère si les reproducteurs n'ont pas combattu. |
| Élevage - Préparation au combat : |
|
On pratique de plus en plus
l'élevage artificiel (couvoir,
lampes
chauffantes) mais la méthode naturelle est la meilleure. On
pose les oeufs que couve une poule bâtarde (la batailleuse
est
mauvaise mère)
sur le "nichot" de paille, et, dès la naissance, c'est la
liberté dans la cour de ferme et la prairie attenante. Comme
les
perdreaux et faisandeaux, les poussins batailleurs adorent petits
insectes et limaçons. Quelques granulés de
premier âge viennent
compléter la nourriture naturelle. Vers 5 à 6 mois les coquelets présentent des signes d'agressivité. Des joutes parfois sanglantes les opposent. Il faut les séparer. Chaque coq est placé dans une cabane de bois : sol en terre battue, perchoir au centre. Désormais prisonnier, il piétine, gratte le sol, bat des ailes, répond aux cocoricos de ses congénères. Pour qu'il "prenne du feu", on le soumet à un régime alimentaire spécial : morceaux de viande, pain grillé imprégné de vin blanc, chanvre,... Pour éviter de donner prise au bec des futurs adversaires, on va le décréter : avec de bons ciseaux, on lui coupe la crête, les barbillons qu'on découpe en morceaux qu'il va manger ... et pour cautériser les plaies, rien ne vaut une toile d'araignée. Encore quelques mois de cabane et il sera "essayé" : on va l'opposer à un coq ayant déjà combattu. Pour éviter des blessures inutiles, on pose sur les ergots des deux adversaires de petits gants de boxe appelés "poquets" : ce sera sont premier round d'entraînement. Il va répondre aux assauts du vieux coq. Quelques joutes sans plus. Il y aura par la suite d'autres entraînements avant le premier combat. |
| Le combat : |
|
Le matin, le coq est pesé, car, comme à la boxe,
on lutte par
catégories (petits jusqu'à 8 livres, moyens de 8
à 9 livres, ...).
Pas de nourriture afin d'éviter un jabot trop lourd. En
début
d'après-midi, il est transporté dans un panier
d'osier jusqu'au
gallodrome, où il sera armé : on pose sur chaque
ergot une arme,
aiguille de 51 mm. Le tout est solidement attaché
à la patte avec une
languette de cuir et du fil de cordonnier. Les deux coqueleux adverses montent alors sur le parc : estrade couverte d'une toile, entourée d'une enceinte grillagée. Les deux coqs sont présentés : plumes du cou hérissées, coups de bec, ... puis ils sont déposés délicatement, déclenchant le charivari produit par les cris des parieurs. C'est le moment crucial si bien décrit par Maxence Van der Meersch ("L'empreinte de Dieu") : " le même bond furieux jette les deux coqs l'un vers l'autre. On les voit s'envoler, armes en avant, s'emmêler, frapper du bec, des ailes, des pattes. Il n'y a qu'une confuse bataille, deux boules vivantes ébouriffées d'ou volent des plumes. Puis les deux bêtes se séparent déguenillantes ... une nouvelle confusion frénétique, le choc de deux fureurs ... ". A cela s'ajoute les aléas du combat : patte ou aile cassée, coq "engavé" (hémorragie asphyxiant l'animal), coq "jeté" (blessure aux reins provoquant la paralysie), coq "fuyard" (la honte pour le propriétaire). Le combat dure six minutes au maximum, mais il se termine souvent avant la limite ! |
| Jury - Règlement : |
| Un arbitre unique est assis derrière une table attenante au parc avec, à portée de la main, une balance pour d'éventuelles pesées, un chronomètre, une rampe de petites lampes qui s'allument suivant les phases du combat (coq couché une minute, cinq minutes de combat,..). D'un geste du doigt, il désignera le vainqueur. Quand au règlement, il est très complexe et il serait trop long d'en développer toutes les dispositions. |
| Mises et paris : |
|
La mise est la somme que verse le coqueleux pour l'engagement de son
coq
: une partie dite "200 X 500" signifie que chaque adversaire
engage 200 F, le vainqueur empochera 500 F. les 100 F
complémentaires
sont versés par l'organisateur du combat. Les paris se font "à la crié" entre les spectateurs. Si un coq d'Haspres a pour adversaire un coq de Saint-Amand, le spectateur qui décide de "miser sur Haspres" crie bien fort "100 F Haspres". "A deux" lui répond un autre spectateur : le pari est engagé. "La clameur du gallodrome, dit Van der Meersch, est celle d'une foule qui échappe à la grise vie quotidienne. C'est une façon de faire communiquer les hommes à la sauvagerie des bêtes." |
| La loi Gramont : |
|
La loi Gramont, datant de 1850, interdisait "d'infliger
publiquement des mauvais traitements aux animaux domestiques". Le
non-respect de la loi pouvait entraîner un emprisonnement de
1 à 5
jours, et une amende de 100 F. Les aficionados et coqueleux
étaient
particulièrement visés, mais certains
prétendaient que le taureau de
combat et le coq batailleur n'étaient pas des animaux
domestiques. Il y
eut procès, cassation, affaires non suivies, combats
clandestins,... En
fait, la coutume persistait. Mais en 1963, une nouvelle loi reprit les dispositions de la loi Gramont. L'infraction pouvant entraîner 6 mois de prison et une amende de dix mille francs (nouveaux). Ce fut alors une levée de boucliers de la part des coqueleux dont la Fédération était forte de 1500 membres. Finalement, le 8 juillet 1964, une nouvelle loi autorisait les combats de coqs là "où il y avait tradition locale ininterrompue.". Ils sont donc interdits dans des localités comme Haspres où la coutume a cessé plusieurs années.
|
|
Les anciens se souviennent des combats de coqs de la
première moitié
du siècle. On a "battu" au Café de la Musique,
chez Uranie
(pharmacie), au Marais, dans la cour du Tiot Mutte... Certains
passionnés ont laissé un nom : Louis dit "Divine"
Louis
Delfosse, El Gris... Époque héroïque
où ils se rendaient dans les
gallodromes voisins en train ou en vélo, avec sur le dos un
sac où
reposait le coq. La seconde Guerre mondiale mit un frein à la coutume, et, lors de la loi d'interdiction de 1963, il n'y avait pratiquement plus de coqueleux haspriens. Mais en 1968, sous l'impulsion de Léon Taisne, une nouvelle société comprenant 20 membres fut refondée. Citons parmi eux Lucien Lemoine dont les coqs redoutables semaient la terreur dans les parcs. Un gallodrome clandestin fut construit au Café de la Concorde. En 1973, l'association Dagniaux - Delfosse remporta le Championnat de Valenciennois avec 15 victoires sur 15 combats. Un merveilleux plat en faïence de Saint Amand immortalise l'exploit. Hélas ! La mort prématurée de Léon en 1984 sonna le glas de cette coutume dont il ne reste plus qu'un souvenir. Monsieur Guy Morelle. |